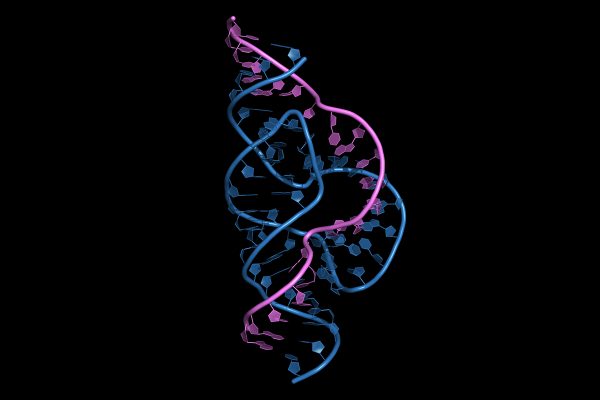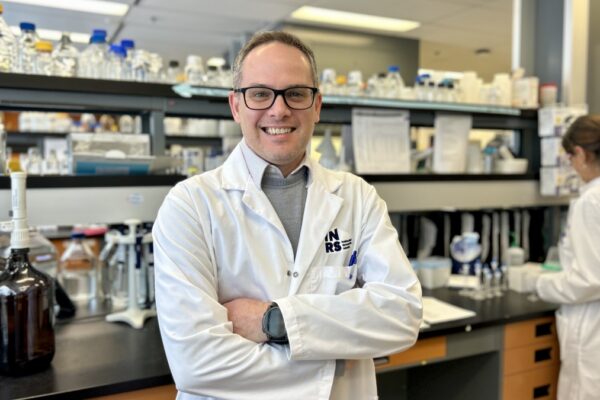- Tour d'horizon
La série « Tour d’horizon en trois questions » met en valeur la recherche sous toutes ses formes et porte un regard éclairé sur l’actualité.

Professeur Fateh Chebana, expert en science des données appliquées à l’environnement et à la santé environnementale à l’INRS. Photo : Josée Lecompte
Comment la recherche peut-elle aider les gouvernements, les municipalités et les organismes à mieux accompagner la population en cas d’événements météorologiques extrêmes ? Grâce à la science des données !
C’est d’ailleurs l’un des nombreux sujets auxquels se consacre le professeur Fateh Chebana, expert en science des données appliquées à l’environnement et à la santé environnementale.
Rattaché à l’Institut national de la recherche scientifique depuis 2010, le professeur Chebana s’intéresse notamment à la manière dont la data science, cette branche scientifique relativement récente, à la frontière entre statistique et informatique, peut aider à prévenir ou à amoindrir les effets négatifs liés aux grandes chaleurs ou aux grands froids.
Ces travaux, de haut niveau multidisciplinaire, font l’objet de collaborations entre l’équipe scientifique de l’INRS et ses nombreux partenaires, parmi lesquels Jérémie Boudreault (INRS), Céline Campagna (Ouranos) et Éric Lavigne (Santé Canada).
Alors que le mercure augmente en cette saison estivale, les enjeux de sécurité en cas de températures extrêmes s’inscrivent entièrement dans l’actualité. Le professeur Chebana nous explique comment son équipe et lui mettent la science au service de la santé publique.
En quoi est-il important d’évaluer et de prévoir les coûts de santé liés aux événements météorologiques extrêmes, comme les canicules ? Qui bénéficie de ce type de recherche ?
Les événements météorologiques extrêmes ont des impacts sur de nombreux secteurs, comme le transport, le tourisme, l’agriculture et la santé humaine. Dans ce dernier secteur, ils touchent la population dans son ensemble, et encore plus certaines sous-populations vulnérables. Parmi les impacts majeurs, on pense entre autres aux nombres de visites à l’urgence, aux hospitalisations, aux décès, aux appels au 811, ou encore au transport ambulancier.

Chacun de ces éléments a des conséquences financières pour notre système social. Notre équipe travaille sur trois grandes catégories de coûts : les coûts directs de soins de santé, comme les frais d’hospitalisations ou le salaire du personnel déployé; les coûts indirects d’absentéisme, c’est-à-dire les heures de travail perdues; et les coûts intangibles, qui comprennent par exemple la volonté de notre société à payer pour réduire les pertes de vies humaines, ou encore la réduction des activités en période de canicule.
Grâce à la science des données, on peut se préparer à de nombreuses éventualités d’un point de vue économique, sociétal, humain, matériel et logistique. À court terme, l’évaluation de ces coûts permet d’accompagner les décideuses et décideurs, afin d’allouer les sommes nécessaires et d’éviter l’improvisation face au danger. À plus long terme, les prévisions de ces coûts selon divers scénarios et hypothèses peuvent guider les autorités sanitaires à investir dans la prévention et dans l’adaptation, comme les espaces verts accessibles, la bonne gestion des ressources et l’efficacité des systèmes d’alerte. Exemple simple : en connaissant le volume et le coût direct du transport ambulancier lors d’une vague de chaleur, une ville comme Montréal pourrait décider d’offrir la gratuité des transports en commun pour libérer les routes et sauver davantage de vie.
Chaque été au Québec, en moyenne 36 000 visites à l’urgence et 7 200 transports ambulanciers sont attribuables aux fortes chaleurs. Ces chiffres risqueraient d’augmenter de plus de 50 % et 60 % respectivement dans un scénario où le globe connaîtra une hausse de + 2°C de sa température. La chaleur extrême a des effets insoupçonnés sur le système de santé au Québec. Selon nos calculs minimalistes, on atteindrait chaque année presque 32 millions de dollars en coûts directs, environ 10 millions en coûts indirects… et 8,4 milliards en coûts intangibles! Si rien n’est fait, on imagine bien que ces coûts auront un impact catastrophique sur notre société. Il faut que nous soyons prévenus et prêts à agir.
À l’heure où les enjeux liés aux températures extrêmes et à la santé des populations touchent tous les pays, existe-t-il une collaboration nationale ou internationale en matière de science des données appliquées à ce domaine?
La recherche dans ce domaine a commencé il y a environ quinze ans à l’INRS. Jusqu’à aujourd’hui, parallèlement à notre participation à des conférences internationales et à la création de liens avec des scientifiques du monde entier, la recherche a surtout été centrée sur des collaborations provinciales. Nous commençons à nous diriger vers des collaborations fédérales, entre autres avec Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada, et avec la Colombie-Britannique et l’Ontario. De plus, la formation nous permet de recruter des étudiants à l’international, comme le chercheur Pierre Masselot, qui est devenu professeur à Londres, et avec qui nous travaillons aujourd’hui.
Les échanges scientifiques actuels en sont à leurs débuts, et l’une des prochaines étapes consistera à comparer et à échanger les bonnes pratiques (méthodes, points de vue, résultats), pour mener à des collaborations plus concrètes.
Divers défis peuvent expliquer l’état actuel de la collaboration internationale et ce cheminement. En premier lieu, la science des données est un sujet assez récent (années 2010, 2015, voire 2020), encore en train de se construire, bien que ses composantes – à la frontière entre mathématiques et informatique – existent depuis plus longtemps. De plus, la santé environnementale est également une discipline assez jeune, qui a commencé à attirer l’attention de façon significative à partir de la vague de chaleur majeure connue par l’Europe en 2003. Somme toute, ce sont donc deux sujets récents!
En outre, même si les températures extrêmes touchent tous les pays, les réponses et les réalités sont propres à chaque gouvernement, municipalité et localité. La comparaison n’est pas toujours faisable.
Ce qui complique la situation est surtout la récolte des données de santé (mortalité, hospitalisation, etc.), puisque l’accès à ces données est protégé par souci de confidentialité et par différents protocoles d’éthique. Les réalités diverses et les intérêts propres à chaque juridiction affectent aussi la recherche. En effet, ce ne sont pas tous les territoires ni tous les pays qui souhaitent investir dans la science et dans la récolte de données. Mais malgré ces défis, la collaboration internationale se construit!
De quelle manière la science des données peut-elle constituer un argumentaire scientifique efficace pour sensibiliser la population et le monde politique à ces enjeux ?
Les changements climatiques amplifieront les épisodes de chaleur en termes de fréquence, d’intensité et de durée. Parmi les mesures permettant de faire face aux impacts sanitaires et financiers, on compte les systèmes d’alerte, la lutte aux îlots de chaleur et la protection des populations vulnérables avec des messages ciblés, du porte-à-porte, l’ouverture de lieux publics climatisés, etc.
La science des données peut contribuer à bâtir un argumentaire scientifique objectif pour aider à la prise de décision et pour sensibiliser aussi bien la population que les décideuses et décideurs. Cela nous permet de considérer des approches et des modèles sophistiqués, plus réalistes, plus représentatifs et plus précis. Ce sujet est assez gourmand sur le plan des données climatiques, sanitaires et économiques nécessaires. Plus on dispose de données, plus les estimations de coûts seront précises et locales. L’argument économique en sera plus convaincant.
Enfin, il ne faut pas oublier que les argumentaires évoluent en fonction des interlocuteurs. L’argumentaire économique s’ajoute à d’autres, comme celui du bien-être, de la protection de la nature, par exemple, afin d’élargir la part des personnes qui seront convaincues et sensibilisées. Selon que l’on s’adresse à une personne issue des milieux communautaire, politique, économique ou scientifique, les mots et les raisonnements seront différents. Avec la science des données, on peut répondre à une même question avec plusieurs angles, sans pour autant délaisser la rigueur scientifique.
Aujourd’hui, les paliers décisionnels s’intéressent beaucoup au côté économique des choses. Quel sera le coût financier de ces canicules pour un hôpital, une ville, un ministère? On peut utiliser la science des données pour répondre à ce besoin de connaissance budgétaire. Déjà avec les travaux récents de notre équipe, au niveau de la province, le gouvernement aura suffisamment d’arguments économiques pour se préparer à chaque période estivale et pour mettre en place des mesures d’atténuation et d’adaptation face aux changements climatiques. Dans ce sens, il faut garder en tête un chiffre intéressant : une somme investie en adaptation face aux températures extrêmes peut générer des bénéfices directs ou indirects jusqu’à 15 fois plus importants. On le voit, il s’agit donc d’un investissement clairement rentable afin d’éviter une facture élevée, et surtout, des conséquences graves pour la société.